Les cybercriminels n’ont plus besoin de forcer les portes : ils utilisent les clés qu’on leur laisse. Dans le cloud comme dans les couloirs du Louvre, tout se joue désormais dans la maîtrise des accès internes.
Lorsque l’on pense à la sécurité du Louvre, on imagine spontanément ses œuvres les plus emblématiques gardées derrière des vitrines renforcées et des systèmes de surveillance sophistiqués. Pourtant, le risque ne se situe pas forcément toujours là où on l’attend. Les évènements récents ont montré que ce ne sont pas toujours les salles les plus prestigieuses qui concentrent les vulnérabilités les plus critiques, mais l’ensemble des accès — humains et techniques — qui permettent d’y pénétrer. Un badge insuffisamment contrôlé ou un identifiant trop simple peut parfois exposer davantage qu’une tentative d’intrusion frontale.
La cybersécurité d’entreprise suit exactement la même logique. L’enjeu ne réside plus uniquement dans la protection des actifs les plus sensibles mais dans la capacité à maîtriser un écosystème d’identités et d’accès devenu plus vaste, fragmenté et difficile à surveiller, en particulier dans les environnements hybrides et multicloud.
Une compromission, un effet domino
Pendant longtemps, seules les identités à privilèges étaient considérées comme réellement critiques. Ce modèle est devenu obsolète. Dans les infrastructures modernes, une identité non humaine — qu’il s’agisse d’une application, d’un service automatisé ou d’une clé API — peut ouvrir autant de portes qu’un compte administrateur traditionnel.
Les entreprises découvrent aujourd’hui que leur surface d’exposition est en réalité structurée par ces milliers d’identités, souvent créées pour gagner en efficacité, mais rarement gérées avec la rigueur nécessaire. Tout comme un badge interne mal utilisé peut permettre d’accéder indûment à des zones sensibles, une seule identité numérique compromise suffit souvent à déclencher un incident majeur. Plusieurs attaques récentes ont démarré par un jeton mal protégé, une clé API exposée ou un script automatisé dont les permissions n’avaient jamais été revues. Dans ce contexte, les cybercriminels n’ont plus besoin de contourner les défenses : ils empruntent simplement les accès légitimes tels qu’ils ont été configurés.
Un écosystème fragmenté qui multiplie les angles morts
La transition vers des architectures distribuées complique encore la situation. Une même identité peut être répliquée dans plusieurs clouds, avec des droits différents selon les environnements, les équipes ou les applications. Cette fragmentation rend particulièrement difficile la réponse à une question pourtant essentielle : qui a accès à quoi, et pourquoi ?
Face à cette réalité, une approche centrée sur l’identité s’impose. Elle consiste à vérifier systématiquement chaque accès, à adapter les privilèges au contexte réel, à surveiller les comportements anormaux et à traiter les identités non humaines avec le même niveau d’exigence que les comptes utilisateurs. L’objectif n’est plus seulement d’empêcher l’accès aux “œuvres”, mais de contrôler l’ensemble des chemins qui y mènent.
Dans un environnement où les entreprises s’appuient sur le cloud, l’automatisation et l’IA, la maîtrise des identités et des accès devient un enjeu stratégique. La résilience ne dépend plus uniquement des protections périphériques mais de la capacité à superviser et gouverner les identités humaines et machines qui orchestrent les opérations quotidiennes. In fine, sécuriser un système informatique revient au même que de protéger le Louvre : au-delà des vitrines, tout se joue dans le contrôle précis de chaque accès.
____________________________
Par Anne Gueneret, directrice commerciale France, CyberArk
À lire également :
Zero Trust : la confiance n’est plus un modèle mais un contrôle permanent
Cloud hybride : les nouveaux enjeux de gouvernance des identités
API et sécurité : quand l’automatisation devient un risque
Les 5 erreurs les plus courantes dans la gestion des identités





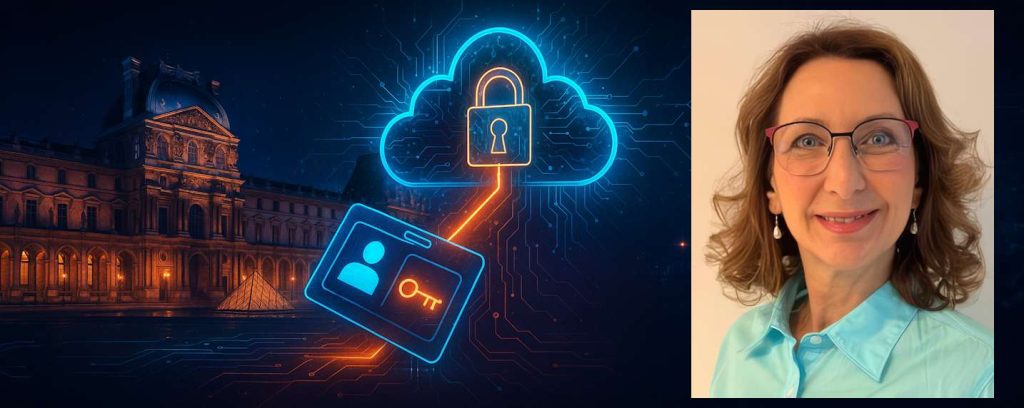
 puis
puis