Chaque rentrée creuse le fossé : d’un côté, les entreprises qui exploitent l’IA pour transformer leurs modèles, de l’autre celles qui accumulent un retard difficilement rattrapable. Face à des marchés de plus en plus agiles, repousser l’IA revient à céder du terrain. L’IA est une clé de la compétitivité.
De l’agriculture de précision à la médecine en passant par la cybersécurité, l’IA est partout et redéfinit les règles du jeu dans l’économie actuelle. Pourtant, en cette rentrée, force est de constater que son adoption reste inégale. Le fossé se creuse entre ceux qui en font un atout et ceux qui subissent son absence. Pour les entreprises, septembre n’est pas seulement reprise et nostalgie de l’été : c’est une fenêtre stratégique pour engager (ou accélérer) leur transformation IA.
Des études récentes montrent que les entreprises ayant intégré l’IA dans leur stratégie voient leur efficacité opérationnelle s’améliorer de manière significative. Selon PwC, d’ici 2030, 70% des entreprises interrogées prévoient déjà une augmentation d’au moins 3 % de leurs bénéfices d’exploitation. À l’inverse, prendre du retard dans le domaine de l’IA pourrait entraîner une perte annuelle pouvant atteindre, en moyenne, 8,6 % de leurs revenus (étude Couchbase, 2025). L’adoption proactive de l’IA n’est donc clairement plus un choix stratégique, elle devient donc une condition de survie économique.
Les risques encourus par les entreprises qui ne tirent pas parti de l’IA
Les entreprises qui repoussent l’IA s’exposent à un déclin progressif de leur avantage concurrentiel, à une perte de compétitivité quasi immédiate, et à une fuite de leurs clients. À l’inverse, d’autres organisations se structurent et innovent rapidement. Salesforce, par exemple, vient d’ajouter une nouvelle couche IA à sa plateforme existante. Celle-ci offre la possibilité à ses utilisateurs de déployer des agents IA autonomes, en un claquement de doigts. Ces agents peuvent, aujourd’hui, gérer des tâches complexes, comme une simulation de lancements de produits ou des réponses en temps réel lors d’interactions humaines.
Les entreprises historiques perdent également des parts de marché, au profit de concurrents plus flexibles. Les secteurs traditionnels (banque, assurance, retail) sont les premières cibles des scale-ups natives IA, étant considérés comme moins agiles.
Les risques encourus se retrouvent également du côté du recrutement des talents. Un véritable handicap se fait sentir dans l’attraction des jeunes diplômés, qui privilégient les entreprises perçues comme à la pointe de la technologie. À terme, c’est la capacité même à innover qui est menacée.
Le coût du retard pris en matière d’innovation dans le domaine de l’IA
Plus une entreprise tarde à adopter l’IA, plus elle devra investir de temps et d’argent pour rattraper son retard. Cela peut entraîner une série de désavantages concurrentiels, allant de l’incapacité à tirer parti des nouvelles opportunités du marché, à la perte de clients et d’employés. Ces mêmes organisations risquent également de subir des pertes importantes de production pendant la transition.
Tout ceci conduit vers une dévalorisation de l’entreprise car, dorénavant, les investisseurs et marchés financiers pénalisent les organisations n’ayant pas de réelle stratégie IA. Selon Auris Finance, la valorisation des entreprises adoptant l’IA peut augmenter de 20 à 50 %, face à celles qui ne prévoient pas d’intégration. En cas de cession d’activité ou d’achat, un audit IA est d’ailleurs demandé, pour analyser, entre autres, le niveau de numérisation et d’automatisation de l’entreprise.
Clef du succès n°1 : favoriser une culture de l’expérimentation
Il est primordial de mettre un terme à la peur de l’échec. L’innovation et l’IA ne sont pas des sciences exactes, et il peut arriver que certains projets échouent – ou du moins ne donnent pas les résultats escomptés, mais ces « échecs » sont des apprentissages essentiels. Il est fondamental d’introduire une culture de l’expérimentation, où l’échec est un apprentissage et où les métiers sont acteurs du changement, au sein de l’entreprise.
Instaurer des bacs à sable réglementaires pour l’IA, dit sandboxes AI, permet de tester, sans danger, les projets dans des environnements contrôlés. L’idée est donc, ici, de favoriser l’innovation, faciliter le développement et la validation avant mise sur le marché.
L’expérimentation est un facteur essentiel pour libérer le potentiel de l’IA. Si de nombreux DSI craignent que les projets ne fournissent pas de résultats concrets, ils ont également conscience que tester ces nouvelles idées et approches permet d’améliorer la compréhension de ces technologies. L’expérimentation peut fournir des informations et des enseignements qui augmenteront les chances de réussite des projets suivants. Les entreprises qui encouragent l’expérimentation obtiennent des résultats plus constants en matière d’IA : leurs projets ont 10 % plus de chances d’aboutir à une mise en production, et elles gaspillent 13 % moins d’argent que les entreprises qui adoptent une approche plus restrictive.
Aussi, il est nécessaire de toujours mesurer l’impact de l’innovation, pas seulement sa performance technique. Les KPI doivent inclure le temps gagné par les équipes, la réduction des coûts opérationnels, ou encore l’amélioration de l’expérience client, par exemple, le taux de résolution des demandes au premier contact grâce à des chatbots augmentés.
Clef du succès n°2 : comprendre ses données pour garantir une IA de qualité
Sans une compréhension approfondie des données, les stratégies d’IA ne peuvent pas aboutir. Des données de mauvaise qualité peuvent engendrer des hallucinations ou introduire des biais. Si les données ne sont pas enregistrées et accessibles en temps réel, l’IA tirera des conclusions basées sur des informations obsolètes ou sera incapable de fournir des conseils opportuns. De plus, si l’organisation ne dispose pas d’une gouvernance efficace des données, l’IA peut facilement devenir un risque pour la sécurité et la conformité.
La qualité d’un projet IA dépend entièrement des données qui l’alimentent. Selon la récente étude de Couchbase (2025), 72 % des entreprises doivent améliorer considérablement leur compréhension et leur maîtrise des données afin d’utiliser l’IA de manière efficace et sûre. Néanmoins, seuls 2 % affirment avoir une compréhension « totale » des données nécessaires au fonctionnement de l’IA. De nombreuses entreprises risquent de mettre un terme à certains projets en raison de données non exploitables. Une structure fiable de la gouvernance des données est donc indispensable.
Septembre 2025 : point de bascule ?
La rentrée a toujours été une période propice à dresser le bilan et prendre de nouvelles résolutions. En 2025, elle doit aussi devenir celui d’un choix décisif. Celui de faire de l’IA un pilier de sa compétitivité ou laisser ses concurrents prendre une avance définitive. Les exemples sont sans appel : les entreprises qui ont attendu 2024 pour agir peinent aujourd’hui à rattraper leur retard, tandis que celles qui ont osé expérimenter dès 2022 en récoltent déjà les fruits.
Les dirigeants de demain ne seront pas ceux qui auront le plus d’IA, mais ceux qui l’auront mieux intégrée – de manière alignée avec leur stratégie business, leurs équipes, et leurs clients. Et ce travail commence maintenant.
____________________________
Par Hervé Oliny, Senior Manager chez Couchbase





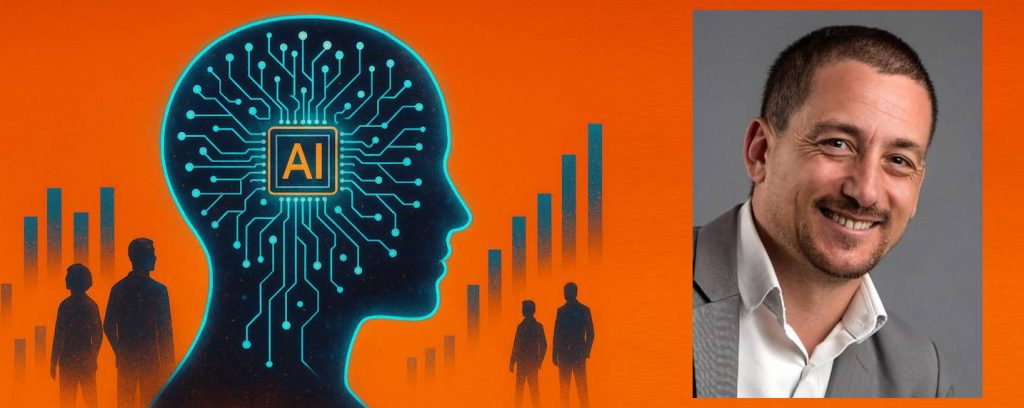
 puis
puis