L’IA dévore toujours plus d’électricité : derrière la course aux datacenters, c’est la robustesse du réseau français qui se retrouve mise à l’épreuve. ntre besoins massifs en mégawatts et quête de sobriété, l’essor des datacenters illustre la tension croissante entre révolution numérique et pression électrique.
Lors du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle, Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d’euros d’investissements privés en faveur du développement de l’IA, dont la moitié dédiée à la construction de datacenters et d’infrastructures associées. Dans ce contexte, Plusieurs acteurs dont EDF ont également pris la parole, afin de soutenir l’émergence d’une IA « à la française ». Cette initiative met en lumière les enjeux croissants liés au développement de l’IA, et notamment la pression qu’il exerce sur le système électrique. Gartner prévoit même un risque de pénurie d’énergie d’ici 2027 en raison de la demande liée au développement de l’IA.
Une France propice mais sous tension
La France présente plusieurs atouts pour l’implantation de datacenters : sa position géographique stratégique et une électricité majoritairement décarbonée, ce qui constitue un avantage environnemental important. Selon RTE, déjà plus de 300 datacenters de grande taille sont recensés sur le territoire, principalement en Île-de-France et à Marseille, cette dernière bénéficiant d’un accès privilégié à 18 câbles sous-marins.
Mais cette croissance rapide de l’IA et des infrastructures numériques met à l’épreuve les capacités électriques nationales. En 2023, RTE France prévoyait un triplement de la consommation d’électricité des data centers d’ici à 2035. L’approvisionnement en énergie devient un enjeu critique : la stabilité du réseau, la capacité de raccordement et la gestion des pics de consommation sont autant de défis que soulève l’essor des datacenters.
L’importance d’anticiper
L’un des principaux défis reste la temporalité : il faut construire vite pour répondre à des besoins immédiats. Or, implanter un datacenter ne se résume pas à ériger un bâtiment : cela suppose un accès immédiat à une alimentation électrique puissante, fiable et redondante.
Si l’on prend l’exemple de la proposition d’EDF qui repose sur l’utilisation de sites existants issus de son patrimoine foncier afin de raccourcir les délais d’installation avec des sites, déjà proches de postes de transformation électrique, facilitant une mise en service rapide, on peut s’interroger sur le nombre de sites disponibles. Une autre piste consiste à favoriser les datacenters modulaires, plus petits, plus agiles mais aussi moins énergivores.
Une équation énergétique de plus en plus complexe
L’implantation d’un datacenter dépend de nombreux paramètres énergétiques : : capacité du réseau local, sécurité d’approvisionnement, coûts de raccordement, disponibilité de sources de refroidissement, ou encore possibilité d’intégrer des énergies renouvelables. On observe d’ailleurs de plus en plus d’expérimentation pour tenter de répondre à cet impératif énergétique.
Deux grands types de datacenters coexistent : les hyperscales, implantés en périphérie urbaine, et les datacenters edge, plus petits et situés au cœur des villes. Tous deux nécessitent un accès fiable tant à l’énergie qu’à Internet, mais soulèvent des questions différentes en termes d’acceptabilité et d’impact territorial. Pour autant, dans les deux cas, les exigences croissantes en matière de stabilité du réseau et de sobriété énergétique posent des questions complexes.
Une pression électrique croissante
L’enjeu n’est pas seulement de produire de l’électricité, mais de la fournir au bon endroit, au bon moment et avec la bonne intensité. Chaque nouveau datacenter exige plusieurs mégawatts de puissance, l’équivalent de milliers de foyers. Le campus PAR01 de DATA4, par exemple, prévoit 24 centres sur 110 hectares, alimentés par des postes très haute tension dédiés.
Cette demande énergétique exponentielle risque de créer des tensions locales, en particulier dans les zones déjà proches de la saturation électrique, et peut venir concurrencer d’autres usages prioritaires : logements, transports, industries essentielles…
Les Etats-Unis sont déjà confrontés à ce problème, en effet pour déployer des datacentres, les hyperscalers s’impliquent directement dans la production d’énergie, à la fois avec des énergies renouvelables mais aussi en relançant le nucléaire, parfois même en faisant appel à des énergies fossiles comme le gaz, peu cher. Ainsi, en Pennsylvanie, une ancienne centrale à charbon va désormais tourner au gaz pour alimenter un centre de données. Ce développement se fait cependant parfois au détriment des habitants.
Réduire la pression par l’innovation
Face à ces enjeux, la réhabilitation de friches industrielles équipées en infrastructures énergétiques peut permettre une meilleure intégration. Mais là encore, les conflits d’usage existent. Certains territoires hésitent à céder leur capacité électrique à des usages numériques perçus comme peu générateurs d’emplois locaux.
Les datacenters modulaires ou intégrant des sources d’énergie renouvelable, du stockage ou des systèmes de récupération de chaleur apparaissent comme des solutions plus compatibles avec la transition énergétique. En mutualisant les infrastructures et en diversifiant les modèles, on peut répondre à la fois à l’urgence numérique et à la nécessité de préserver l’équilibre du réseau électrique.
____________________________
Par Pascal Lecoq, Directeur monde de la modernisation responsable des centres de données, chez HPE.





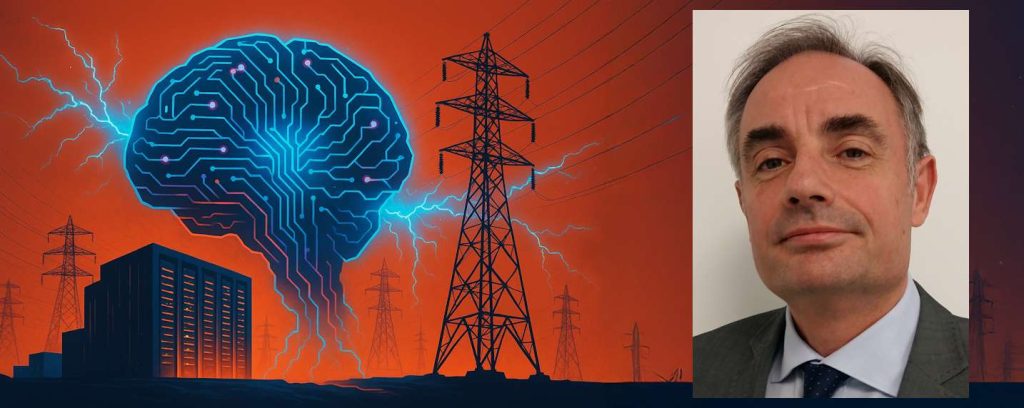
 puis
puis